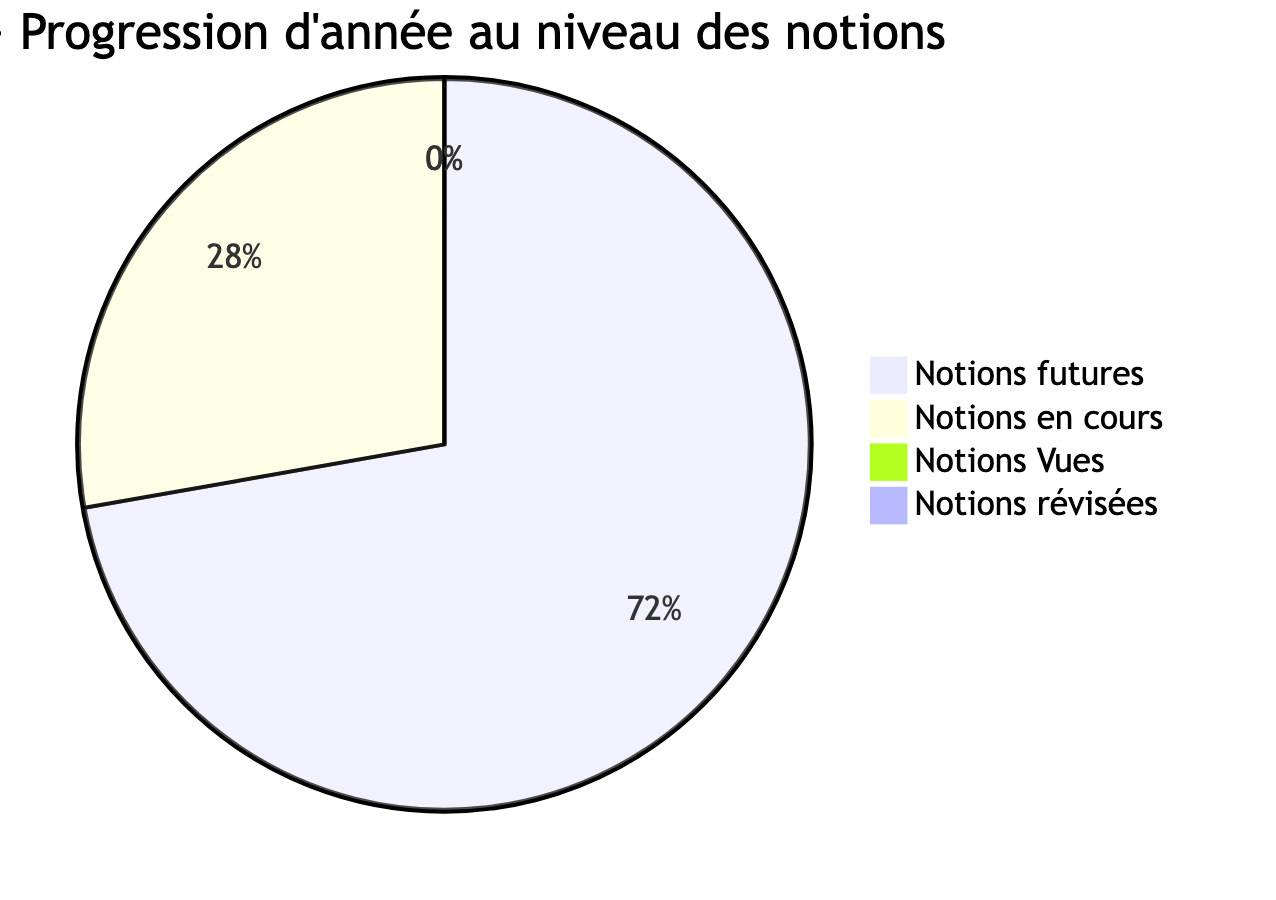J’ai choisi comme fond d’écran pour cet article une chouette en pensant à la célèbre phrase du philosophe allemand Hegel dans ses Principes de la philosophie du droit (1820) :
« Ce n’est qu’au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol ».
Il faut en effet du temps pour devenir réellement philosophe, et la chouette de Minerve, qui symbolise la Sagesse pour les grecs anciens, nous le rappelle. Aristote pensait d’ailleurs qu’il était très rare de devenir philosophe avant l’âge de 50 ans.
Vous trouverez le document PDF correspondant à cet article ici : Philosophe.
Le philosophe n’est pas un sophiste #
Le mot philosophe vient du grec ancien philosophos composé à partir de philo et de sophia. Philo signifie celui qui aime d’un amour d’amitié et sophia sgnifie la sagesse. Le philosophe c’est donc l’ami de la sagesse. C’est en tout cas le sens originel du mot. Cela ne veut pas dire que le philosophe prétend détenir la sagesse. Cela veut dire que le philosophe recherche la sagesse de tout son cœur.
Socrate semble être l’un des premiers à avoir utilisé le mot. Il l’opposait aux maîtres avec lesquels il avait étudié que l’on désignait à son époque par le mot sophistes. Le sophiste, c’est celui qui proclame posséder la sagesse et qui se fait payer pour enseigner cette sagesse à ceux qui veulent l’obtenir. Le mot sophiste vient lui aussi de sophia, la sagesse.
Dès le départ nous avons donc le philosophe qui s’oppose aux sophistes. Les sophistes sont célèbres et reconnus par la société, mais ce qu’ils recherchent, c’est surtout le pouvoir, les richesses et les honneurs. Le philosophe n’est pas forcément aussi connu mais ce qui le différencie surtout des sophistes, c’est qu’il recherche avant tout la sagesse, c’est-à-dire la vérité et le bien. Les philosophes ont donc tendance à déplaire aux puissants cupides et aux foules manipulées par eux. Il est certainement plus dangereux d’être philosophes qu’être sophistes. Le sophiste sait plaire. Le philosophe ne cherche pas à plaire, il cherche à connaître le réel et à faire le bien.
Pour le sophiste, la sagesse n’est qu’un moyen, un moyen de séduction, un instrument au service de ses intérêts. Le mensonge et la dissimulation sont ses armes principales. Il peut d’ailleurs utiliser ces armes sans s’en apercevoir car il peut aussi se mentir à lui-même en croyant rechercher la vérité alors qu’il recherche le pouvoir et la reconnaissance.
Le sophiste, ce n’est pas l’idiot du village, ou le paresseux. Le sophiste est motivé et studieux. C’est un homme intelligent, rusé et entreprenant. Ce qu’il veut, c’est plaire au monde pour augmenter ses richesses, et cela demande donc de réels efforts de sa part. Une fois que nous avons repéré un homme comme étant sophiste, il peut être un maître utile à fréquenter. Il possède en effet une réelle connaissance du monde et de sa logique mercantile, des hiérarchies sociales et des honneurs reconnus.
Difficulté à distinguer le sophiste du philosophe #
Il est difficile de distinguer le philosophe du sophiste car le pouvoir de séduction du sophiste fait sa force. La renommée d’une personne, qu’elle soit sociale, médiatique ou officielle, ne garantit malheureusement rien. Le nombre d’admirateurs ne garantit rien non plus. En effet, comme nous le verrons dans le cours sur la vérité, la vérité n’est pas fonction du nombre de personnes qui la proclament. C’est pourquoi la réputation n’est pas un signe suffisant pour distinguer le philosophe du sophiste.
Nous verrons un peu plus loin ce qui peut nous aider à les distinguer. Mais avant cela revenons aux origines historiques de la philosophie.
Origine historique de la philosophie #
Socrate #
Socrate (-470,-399) est le premier grec ancien à distinguer le philosophe du sophiste, en se disant philosophe. Il apprend aux jeunes hommes qu’il rencontre dans les rues d’Athènes à s’interroger sur ce qu’ils savent vraiment. Sa méthode d’enseignement et de questionnement est surprenante, on l’appelle maïeutique, en référence à Maïa, l’aînée des Pléiades, la mère du dieu Hermès. Maïa était la déesse des sages-femmes. La maïeutique est une méthode qui consiste à aider à l’accouchement de l’âme de l’interlocuteur.
Platon #
Socrate n’a écrit aucun livre, on le connaît donc essentiellement grâce à deux de ses élèves : Xénophon (-430,-355) et Platon (-427,-347). Le Socrate dont on parle en philosophie est le plus souvent celui qui est décrit dans les Dialogues de Platon. Ce dernier a eu Socrate comme professeur. Il a ensuite fondé une école, l’Académie, dont la devise était : « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ! »
Aristote #
Platon a eu de nombreux élèves, mais le plus célèbre et aussi le plus doué fut Aristote (-384,-322). Il est le fils du médecin personnel du Roi de Macédoine, mais il perd ses parents quand il n’est encore qu’un enfant. Après avoir été élevé à la cour du Roi de Macédoine avec le Prince Philippe, il part à Athènes où il devient le meilleur élève de Platon à l’Académie. Mais à la mort de Platon, au lieu de prendre sa suite, il est appelé à la cour du nouveau Roi de Macédoine (son ami d’enfance) pour devenir le précepteur de son fils, le futur Alexandre Le Grand. Quand Alexandre devient empereur, Aristote retourne à Athènes pour fonder une nouvelle école : Le Lycée.
C’est l’un des plus grands philosophes de tous les temps, et encore aujourd’hui sa pensée reste une référence dans de nombreux domaines. Il est le père fondateur de la biologie, de la logique et de la métaphysique. Il faudra attendre Carl von Linné (1707-1778) pour que sa classification des animaux soient retouchées. De plus, Georges Cuvier reprendra les intuitions d’Aristote pour améliorer la classification de Linné. Comme nous le rappel le philosophe français Pierre Pellegrin dans son livre Des animaux dans le monde, Cinq questions sur la biologie d’Aristote :
“C’est d’ailleurs dans une lettre qu’il a écrite à William Ogle le 22 février 1882 en remerciement de l’envoi de sa traduction des Parties des animaux que Darwin a écrit la phrase, devenue très fameuse et souvent citée, « Linné et Cuvier ont été mes deux dieux, bien que de manières très différentes, mais ils n’étaient que des écoliers par rapport au vieil Aristote ».”
Ceux qui opposent Darwin et Aristote ne connaissent généralement pas les textes d’Aristote sur la biologie. Il faut dire qu’il a fallu attendre les années 1950 aux États Unis d’Amérique pour que les philosophes contemporains relisent ses textes sur la biologie à la lumière des avancées scientifiques de notre époque. Autant la physique d’Aristote peut nous sembler dépassée, autant certaines de ses intuitions en biologie sont toujours d’actualité même s’il n’avait évidemment pas les moyens technologiques à l’époque pour découvrir l’ADN.
Le grand philosophe du Moyen-Âge, Thomas d’Aquin, l’étudiera de manière très précise, et quand il le cite, il l’appelle Le Philosophe. C’est dire l’estime qu’il porte à Aristote et il est loin d’être le seul philosophe à penser de la sorte. Il est bon de noter que Napoléon Ier a choisi d’appeler l’institution chargée d’éduquer les personnes de votre âge : Le Lycée. La République Française a aussi conservé cette appellation.
Astuce pour distinguer le philosophe du sophiste #
Pour les reconnaître il est bon d’utiliser le proverbe chrétien suivant : « On reconnaît un arbre à ses fruits ». Pour le comprendre, il est bon de se poser les questions suivante :
- Combien de temps faut-il pour qu’un fruit pousse et mûrisse ?
- Que désigne la métaphore du fruit ?
- Qui peut savoir si le fruit est bon ?
Si nous réussissons à reconnaître le sophiste pour ce qu’il est, il peut nous apprendre des choses car il ne ment pas tout le temps sinon il ne séduirait pas. PRUDENCE cependant.
La Sagesse comme amour du Bien et de la Vérité #
Faire le bien demande de rechercher la vérité #
Pour faire le bien, il est nécessaire :
- De connaître au mieux le monde qui nous entoure, avec l’idée qu’une connaissance confuse ou une connaissance partielle est meilleure qu’une absence de connaissance ;
- De se connaître au mieux soi-même : ce qui est loin d’être facile !
La recherche de la vérité est donc indispensable. Par exemple, pour l’orientation post-bac, ne faut-il pas :
- Connaître le fonctionnement de son intelligence, de sa mémoire, de sa volonté ?
- Connaître les contraintes de la formation et celles des débouchés ?
- Distinguer l’envie passagère du désir profond ?
Définition de la vérité #
Cela veut dire deux choses :
- Une proposition est vraie si et seulement si elle correspond à la réalité qu’elle décrit.
- Une pensée peut être vraie sans réussir à s’exprimer correctement en mots de notre langue. Cependant tant que nous ne pouvons pas l’exprimer, elle ne peut ni être communiquée ni être critiquée.
C’est pourquoi la devise de Socrate que nous avons déjà vue, « Connais-toi toi-même ! » est si importante. Pour commencer à introduire le cours sur la liberté, il est bon de préciser que la connaissance de soi commence par la connaissance de ses désirs. C’est ce que disait Augustin dans cette phrase célèbre : « Ce n’et que lorsque nous commencerons à réfléchir à nos désirs que nous commencerons à réfléchir tout court ! »
L’amitié pour la Sagesse #
La philosophie c’est, comme nous l’avons déjà dit, l’amour de la Sagesse, et donc aimer faire le bien et aimer la vérité pour être efficace dans le bien que l’on veut faire. De quel amour s’agit-il ici ? Pour les premiers philosophes grecs, il s’agit de l’amitié. Mais qu’est-ce que l’amitié ?
Fausses et véritable amitiés #
Aristote dans son livre Éthique à Nicomaque distingue deux fausses amitiés et une véritable amitié :
- Les fausses amitiés :
- L’amitié selon le plaisir ;
- L’amitié selon l’intérêt.
- La véritable amitié qui est la Bienveillance Manifeste Réciproque.
Distinction entre amitié et fraternité #
Nous choisissons nos amis et nous sommes choisis par eux. Nous ne choisissons pas nos frères et sœurs, mais cela ne nous empêche pas de nous aimer. D’où l’importance de la famille : c’est le lieu où nous pouvons apprendre à aimer ceux que nous n’avons pas choisis. C’est pourquoi le fait que nos familles connaissent des conflits peut nous atteindre au plus profond et nous désespérer.
Trois concepts différents de fraternité #
Nous pouvons retenir la distinction conceptuelle suivante :
- La fraternité familiale ;
- Les fraternités électives qui ne reconnaissent que ceux qui appartiennent au même CLAN. On peut parler alors d’esprit clanique. Il se manifeste par le rejet de ceux que nous n’avons pas choisi avec l’excuse, d’une stupidité malheureusement trop commune, qu’il serait impossible d’aimer tout le monde. C’est évidemment confondre l’amour avec l’affection ou l’émotion d’amour.
- La fraternité universelle qui envisage l’humanité comme notre famille humaine. Elle considère que chaque personne est riche de ses différences et que la multiplication des différences enrichit l’humanité. La fraternité universelle n’est cependant possible que si nous cessons d’être naïf concernant la méchanceté humaine. La méchanceté existe, il est donc impossible de défendre la fraternité universelle sans la vertu de prudence. Cependant il est bon de rappeler cette vérité indubitable : tout ami est d’abord un inconnu.
Bienveillance de la Sagesse à notre égard #
De manière surprenante et parfois difficile à croire sans l’avoir vécu, la Sagesse nous rend l’amour que nous lui portons. C’est une foi en la Sagesse que l’on trouve dans plusieurs cultures :
- Chez les philosophes grecs comme Socrate, Platon et Aristote ;
- Chez les juifs ;
- Ches les chrétiens ;
- Chez les musulmans ;
- Mais aussi dans différentes religions du monde.
Cette confiance en la Sagesse et son action pour nous ne doit être ni naïve ni illusoire. En effet, la justice immanente est rarement de ce monde. Les injustices existent réellement, malheureusement ! Et pourtant, celui qui choisit la Sagesse, bien que parfois rejeté par le monde, peut recevoir énormément et donner énormément aux autres : pensons par exemple à Martin Luther King au XXème siècle et à l’impact qu’il a eu sur son propre Pays et sur le monde, malgré son assassinat.